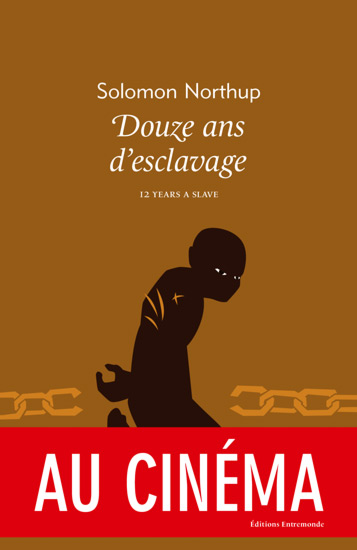
collection
— Rupture
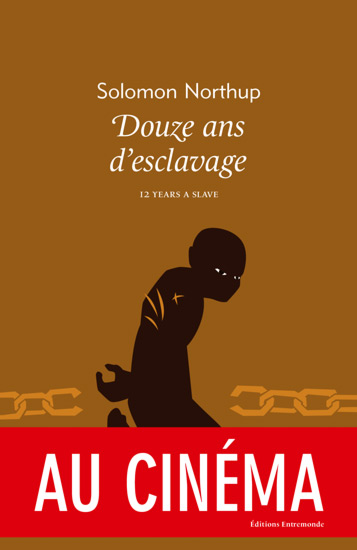
16 € / 20.8 CHF
28 novembre 2013
130x200 cm
3e tirage
ISBN 978-2-940426-27-0
ISSN 1662-3231
Presse écrite
— Trois Couleurs, n° 117, hiver 2013-14 par Juliette Reitzer, Éditeur MK2 Agency
— Positif, par Michel Ciment, Éditeur Actes Sud
— Le Monde, supplément culture et idées, 16 janvier 2014, par Anne Chemin
— Jeune Afrique, 19 janvier 2014, par Tshitenge Lubabu
— Télérama, 22 janvier 2014, par Frédéric Strauss - 20 minutes, 22 janvier 2014, par Caroline Vié
— Tribune de Genève, 22 janvier 2014, par Marianne Grosjean
— Le Figaro, 22 janvier 2014, par Mohammed Aïssaoui
— La Voix de l’Oranie, 23 janvier 2014 - L’Hebdo, 23 janvier 2014,
par Stéphane Gobbo, Éditeur Ringier
— Le Courrier, 25 janvier 2014, par Philippe Bach - Le Devoir, 1 février 2014, par Odile Tremblay
— Books Magazine, 27 février 2014.
Radio
— La Grande Table, par Caroline Broue, diffusion le 21 janvier 2014, France Culture
— Projection privée, par Michel Ciment, diffusion le 25 janvier 2014, France Culture
— Plus on est de fous, plus on lit !, par Biz, diffusion le 27 janvier 2014, Radio-Canada
— La Fabrique de l’Histoire, table-ronde avec E. Laurentin, A. Farge, F. D’Almeida, P. Ory et S. Liatard, diffusion 7 février 2014, France Culture
— La marche de l’histoire, par Jean Lebrun, diffusion le 12 février 2014, France inter
Télévision
— La Culture est dans la rue, par Guy Registe, entretien avec Matthieu Renault, diffusion le 30 janvier 2014, Telesud
— Infô Soir, diffusion le 22 janvier 2014, France Ô
— Grand Public, par Sophie Pagès, diffusion le 11 janvier 2014, France 2
— Rencontres de cinéma, par Laurent Weil diffusion le 19 janvier 2014, Canal+
Internet
— Jeuneafrique.com, par Laura Fortes, 13 janvier 2014
— 20minutes.fr, 9 janvier 2014
Douze ans d’esclavage
Solomon Northup
12 Years a Slave
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Philippe Bonnet et Christine Lamotte
Introduction et postface de Matthieu Renault + Lire
Le récit du nouveau film de Streve McQueen 12 Years a Slave sortie en France le 22 janvier 2014 dans plus de 600 salles.
Ce livre raconte l’histoire de Solomon Northup, un menuisier et violoniste noir du Nord. Homme libre, il est enlevé une nuit alors qu’il voyage loin de chez lui pour être vendu comme esclave. Pendant douze ans, il vit « l’institution particulière » de près : travail forcé de l’aube jusqu’au crépuscule et des coups de fouet sans cesse. Quand il retrouve enfin son statut d’homme libre, il s’attèle à décrire minutieusement ce qu’il a vécu et ce livre en est le résultat. Malgré son calvaire, il réussit à décrire l’économie du Sud avec un œil de sociologue, une économie agraire qui comble son manque de productivité et son retard en matière d’industrialisation avec cette main d’œuvre particulièrement peu coûteuse que sont les esclaves. Ce récit, qui choque par sa cruauté, est également à la base du film de Steve McQueen prévu pour l’automne 2013.
Solomon Northup (né en juillet 1808, mort entre 1864 et 1875) est un afro-américain né libre à Saratoga Springs, New York, qui fut enlevé pendant un voyage à Washington et mis en esclavage. Après sa libération, il s’engagea dans les mouvements abolitionnistes et dans le chemin de fer clandestin.
Postface
Dire-vrai sur l’esclavage : un autre point de vue
« Pensez-y : pendant trente ans un homme, avec tous les espoirs, les peurs et les aspirations d’un homme – avec une femme et des enfants pour l’appeler par les doux noms de mari et de père – avec une maison, aussi humble soit-elle, mais tout de même une maison… puis pendant douze ans une chose, un bien mobilier, classé parmi les mules et les chevaux… Oh ! C’est affreux. Cela glace le sang de penser que de telles choses existent »1. Ces mots sont ceux de Frederick Douglass qui non seulement est l’auteur de ce qui demeure jusqu’à aujourd’hui le plus célèbre des récits d’esclaves, mais qui était aussi une figure majeure du mouvement abolitionniste américain. Dans cet article paru en août 1853 dans The Liberator, juste après la publication de Douze ans d’esclavage, Douglass témoigne du sentiment d’effarement qui ne peut manquer de saisir le lecteur de ce récit d’un homme qui, de son aveu même, est « né libre, dans un État libre », a été « enlevé et vendu comme esclave, avant d’être heureusement libéré au mois de janvier 1853 » (p. 11).
« C’est une histoire étrange », dit encore Douglass « sa vérité est plus étrange que la fiction »2. Ce n’est pas là une réflexion littéraire de circonstance car Douglass n’était pas sans ignorer que la nature exceptionnelle du récit de Northup risquait d’éveiller des suspicions quant à son authenticité ; ou, plus précisément, d’éveiller plus de suspicions encore que les récits d’esclave qui l’avaient précédé. En effet, l’épineuse question de l’authenticité du discours des (ex-) esclaves était devenue un lieu commun des débats et controverses entourant la question de l’abolition de l’esclavage, d’où les efforts déployés par les adversaires du système esclavagiste pour défendre la véracité de ces récits. Il suffit de se reporter à la presse abolitionniste de l’époque pour s’en convaincre. Voici quelques exemples provenant de différents journaux et portant sur différents récits : « Nous avons connu personnellement Douglass et Henson et, sans parler de l’évidence interne de vérité que leurs histoires offrent, nous avons toutes les raisons de leur faire confiance comme à des hommes de vérité » ; « Nous n’entretenons aucun doute à l’égard de l’authenticité générale de cette très intelligente et intéressante histoire d’un Africain » (Olaudah Equiano) ; « Une seule chose est si frappante : que son étrangeté, son improbabilité […] détermine la vérité de l’histoire. […] Je maintiens qu’aucun homme n’aurait pu inventer cette histoire ; […] Le récit de James Williams est donc irrécusablement vrai »3.
Qu’en est-il du récit de Northup ? Son écrivain-éditeur, David Wilson, écrit dans sa préface à la première édition de l’ouvrage : « Que [Northup] ait adhéré strictement à la vérité, l’éditeur, au moins, qui a eu l’opportunité de détecter n’importe quelle contradiction ou divergence, en est convaincu »4. Northup l’affirme lui-même au cours du récit : « Je peux désormais parler des maux que j’ai soufferts […] et je n’ai d’autre désir, en le faisant, que de m’en tenir à la stricte vérité » (p. 136). Relatant le procès qui l’oppose, à Washington, à Burch et ses complices, Northup déclare « absolument mensongère » toute autre version que la sienne, lui « qui [sait] la vérité » (p. 248). Il rappelle enfin, dans les dernières lignes de son récit, que l’histoire qu’il a confiée « n’est ni un roman, ni une invention » (p. 249). De fait, l’authenticité historique du document de Northup ne sera jamais réellement remise en cause et la plupart des évènements relatés seront définitivement corroborés.
Est-ce à dire que cette revendication de vérité ait pour seule fonction (rhétorique) de prouver la vérité du discours contre ses potentiels objecteurs, une fonction (défensive) de légitimation identifiant véridiction et vérification ? Non, car ce dire-vrai sur l’esclavage est aussi, pour celui qui a été sommé de se voir à travers les yeux de son maître et de se taire au premier son de sa voix, un dire-vrai sur soi. Il est, pour celui qui a été ravalé au rang des objets, l’amorce d’un processus de subjectivation. La pratique autobiographique de l’esclave relève en ce sens de l’aveu. Dans ses conférences de 1981 à l’Université de Louvain, Michel Foucault définit cette « technologie du sujet » qu’est l’aveu de la manière suivante : « l’aveu est un acte verbal par lequel le sujet, dans une affirmation sur ce qu’il est, se lie à cette vérité, se place dans un rapport de dépendance à l’égard d’autrui et modifie en même temps le rapport qu’il a à lui-même »5. Cette définition doit néanmoins être altérée, et peut-être même renversée, si l’on désire rendre compte de l’aveu de Northup comme de celui des autres esclaves qui ont narré leur histoire ; car leurs aveux ont précisément pour fonction d’instaurer un rapport d’indépendance à l’égard d’autrui sous la figure du maître6. De ce point de vue, l’aveu de l’esclave est une pratique de libération, plutôt que de liberté, pour rejouer une opposition foucaldienne – une libération qui prolonge, et peut-être achève, la sortie des fers de l’esclavage. C’est pourquoi les fonctions politiques (abolitionnistes) et les fonctions subjectives du récit de Northup sont inséparables.
La condition de possibilité de ce nexus de l’individuel et du collectif, c’est l’affirmation d’un point de vue propre de l’(ex-) esclave sur l’esclavage. Citons à nouveau Douglass : l’homme libre « ne peut pas voir les choses sous le même angle que l’esclave, puisqu’il ne regarde pas, et ne peut pas le faire, depuis le même point que l’esclave »7. Ce que nous appelons aujourd’hui une « théorie du point de vue » est déjà ici en germe. Qu’on ne lise que ces quelques lignes d’un article du Christian Examiner publié en 1849 : « Nous avons toujours été familier avec l’esclavage vu du côté du maître. Ces récits montrent à quoi il ressemble vu du côté de l’esclave. Ils contiennent le récit de la victime sur le fonctionnement de cette grande institution »8. Northup quant à lui, tout en se sachant faire partie « d’une race avilie et tyrannisée, dont l’humble voix peut bien ne pas être entendue de l’oppresseur » (p. 247), n’en appelle pas moins tous ceux qui osent disserter sur « les plaisirs de la vie d’esclave » à apprendre à « connaître l’âme des pauvre esclaves ; à pénétrer leurs pensées secrètes – celles qu’ils n’oseraient jamais exprimer à l’oreille d’un Blanc » (p. 154). Relater l’expérience de l’esclavage, c’est pour Northup dire tout haut ce que les autres (esclaves) pensent tout bas.
Exprimer le point de vue de l’esclave, c’est donc rendre compte d’une expérience vécue qui, aussi subjective et intime soit-elle, n’en est pas moins, dans les États esclavagistes, partagée par toute une « race ». Ce vécu est d’abord celui d’un corps exposé à de terribles souffrances dont le symbole même (très concret) est l’épreuve de la flagellation : « Je crus bien mourir sous les coups de cette infecte brute. […] J’avais le corps en feu. Seuls les tourments de l’enfer pourraient donner une idée exacte de ce que j’endurais » (p. 30). Dans le champ de coton, l’usage du fouet est quotidien, c’est la norme : « Une fois finie la pesée, arrive l’heure de la fouettée » (p. 125). De victime, il est parfois exigé de l’esclave qu’il devienne le bourreau de ses compagnons de misère et lorsqu’il se rétracte, le maître prend le relais avec d’autant plus de violence : Patsey « était horriblement lacérée […] Le fouet était trempé de sang, qui coulait le long de ses flancs et tombait goutte à goutte sur le sol. À la fin elle cessa de se débattre. Sa tête retomba inerte. […] Lorsque le fouet lui arrachait de petits morceaux de chair, elle ne se crispait plus, ni ne se raidissait. Je pensais qu’elle allait mourir ! » (p. 198).
Northup ne cesse par ailleurs de montrer que la vie en esclavage est une vie à proximité de la mort, une mort dans la vie, ou encore, pour reprendre les mots d’Orlando Patterson, une « mort sociale »9. C’est une « vie » à laquelle la mort serait préférable : « Il m’est arrivé bien souvent dans ma vie d’infortune de songer avec joie à la mort comme à la fin de mes souffrances terrestres, à la tombe comme au repos de mon âme » (p. 99). C’est pourquoi la mort charnelle peut s’offrir comme une véritable libération : « Un soir, quand les ouvriers rentrèrent du champ, ils trouvèrent [Eliza] morte ! […] Elle était enfin libre » (p. 120). En esclavage, la seule liberté est une liberté dans la mort. Cependant, pour Northup, chez lequel la question du suicide des esclaves est absente, l’esclave ne saurait choisir la mort, sa mort. Or, nombre d’esclaves avaient bel et bien fait ce choix – sans toujours pouvoir le mettre à exécution. Olaudah Equiano écrit ainsi à propos de son transfert sur le bateau négrier : « Nous fîmes le projet de brûler le vaisseau et de périr tous ensemble »10. Néanmoins, comme le fait remarquer Grégoire Chamayou, quand bien même cette révolte signerait la destruction du maître, elle n’en resterait pas moins « sans issue » : cette liberté dans le suicide, fût-il héroïque, demeure une liberté abstraite ; elle ne saurait permettre de vivre une vie libre, sans compter que ce « choix » entre la vie dans l’esclavage et la liberté dans la mort n’était de fait d’autre que la seule alternative ouverte par le maître lui-même, une expression de sa domination : « Et tant que, pour les esclaves, la seule façon d’être libres étaient d’être morts, les affaires pouvaient aller bon train »11.
Résister
Ce que démontre Northup, c’est que sans cesser d’être une pure victime de l’esclavage, l’objet de son maître, l’esclave ne consent pourtant jamais totalement à sa propre servitude. Dans sa magistrale étude sur l’esclavage, Patterson souligne à quel point est superficiel l’argument selon lequel l’esclave intériorise entièrement l’image dégradée de lui-même que lui renvoie le maître, sa dégradation personnelle s’identifiant alors à sa dégradation matérielle : « c’est presque l’opposé qui est vrai »12. Chez Northup lui-même, ce refus passe par la mise en œuvre de toute une série de mécanismes de défense, de « petites » résistances.
La première d’entre elles, la plus constante également, repose sur une revendication de liberté jamais démentie : « Je soupirais après ma liberté » (p. 93). Jamais l’auteur n’oublie-t-il le « pays de la liberté », le « sol de l’État libre dans lequel [il] est né » (p. 136), cet ailleurs hors de l’espace et du temps de l’esclavage, cette hétérotopie où il n’y a « ni esclaves, ni maîtres »13. Ce lieu n’est pas seulement un espace géographique, c’est aussi un principe, une idée : c’est l’idée même des États-Unis telle qu’elle s’incarne dans la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776 que Northup cite : « Nous regardons comme des vérités évidentes en elles-mêmes que tous les hommes ont été créés égaux, qu’ils ont reçu de leur créateur certains droits inaliénables : qu’au nombre de ces droits sont la vie, la liberté, la recherche du bonheur » (p. 28). Placer ces mots en regard de l’expérience de l’esclave, c’est révéler la fondamentale iniquité du système esclavagiste. Au-delà de sa situation personnelle d’homme né libre, Northup affirme que l’opinion selon laquelle « l’esclave ne conçoit pas l’idée de la liberté, qu’il ne comprend même pas ce que ce mot veut dire », est purement et simplement fausse. Même là où l’esclavage est le plus cruel, « le plus ignorant des esclaves », mesurant sa condition à celle de son maître, connaît parfaitement la signification du mot « liberté » (p. 200). Les esclaves nourrissent « presque tous un désir de liberté » (p. 15). Presque tous, quatre vingt dix-neuf pour cent se risque-t-il à dire, « sont suffisamment intelligents pour se rendre compte de leur situation et chérir dans leur cœur, aussi passionnément que [les Blancs], la liberté » (p. 155).
La question qui traverse le récit de Northup est en somme la suivante : Que faire de la liberté ? Que faire pour qu’elle ne s’évanouisse pas, laissant les ténèbres de l’esclavage éteindre toute lueur d’espoir ? Cette liberté, pense Northup au lendemain de son enlèvement, il faut l’exprimer, la dire et la redire : « J’affirmai bien haut, que j’étais un homme libre, un citoyen de Saratoga, où j’avais femme et enfants, libres également, et que je me nommais Northup. » (p. 29) Que cette déclaration, faite dans la geôle de Burch à Washington, vaille à son auteur une violente correction, il s’en moque et ne rompt pas : « Quand il eut le bras fatigué, il s’arrêta et me demanda si je maintenais toujours que j’étais un homme libre. Je le répétai avec force, et les coups redoublèrent. […] Ses coup brutaux ne parvinrent pas à me faire avouer que j’étais un esclave. » (p. 30) Au faux aveu qu’on le somme de proférer, Northup oppose le vrai aveu de sa propre liberté.
Il s’aperçoit néanmoins rapidement que cet aveu ne lui apporte que des ennuis, que cette vérité ne fait que déclencher la colère des esclavagistes tels Burch : « Si jamais je t’entends dire un seul mot sur New York ou sur ta liberté, ce sera ta mort. Je te tuerai, tu peux me croire. » (p. 41) Northup va alors suivre le conseil que lui avait donné un autre esclave de « ne plus parler à l’avenir de ma liberté, car […] cela ne pourrait finir que par de nouveaux coups de fouet » (p. 33). Il comprend qu’il lui faut « cacher l’histoire de [sa] vie » (p. 212) car ce serait « une folie de [sa] part que de proclamer [son] droit à la liberté » (p. 212). Il ne dira désormais plus rien de sa « véritable identité » (p. 64). Il ne s’agit en rien d’oublier la liberté, mais bien plutôt de la retenir en soi, de contenir toute expression, de la rendre muette, de la dissimuler : « Je décidai donc d’enfermer ce secret dans mon cœur et de ne jamais articuler une syllabe à ce propos. » (p. 65) La liberté n’en devient pas pour autant silencieuse, elle se dit bel et bien encore, mais elle ne se dit plus qu’intérieurement, comme un aveu à soi-même, dans lequel le sujet est à la fois celui qui avoue et celui à qui il avoue ; un aveu qui est déjà un acte de résistance, fût-il encore du seul ordre de la préservation-conservation de soi14.
Que la vérité ne puisse plus être dite que dans le for intérieur de l’esclave signifie également que les relations au maître ne peuvent qu’être traversées par le mensonge. Dans la société des maîtres règne l’axiome selon lequel « le nègre est un menteur » : « Jurant et blasphémant, il me traita de sale menteur de nègre. » (p. 29) De la vérité, le maître se moque pourtant éperdument ; elle ne l’intéresse qu’à partir du moment où elle s’identifie à son désir de puissance, se convertit en instrument de domination. C’est pourquoi « il ne fait pas bon contredire un maître, même au nom de la vérité »15. Dans ce contexte, vérité et mensonge ne sont plus rien d’autre pour l’esclave que des réflexes de survie.
Si le maître ne se trompe donc pas toujours lorsqu’il affirme que l’esclave est un menteur, il n’en demeure pas moins tout à fait ignorant des causes véritables de ce mensonge tout aussi bien que de ses occasions.
Il y a bel et bien chez l’esclave un certain « retournement du stigmate », ce que l’on pourrait appeler une technique du mensonge, du dire-faux ou encore du désaveu ainsi qu’en témoigne mieux que toute autre la scène qui fait suite à la délation de Northup par Amsby auquel il avait demandé s’il accepterait de poster une lettre pour lui. Comment Northup parvient-il à se tirer de cette sale affaire ? Lorsque son maître, Epps, l’interroge, il feint tout d’abord « l’ignorance et la surprise », niant avoir présenté une quelconque requête à Amsby. Puis il affirme : « Ce que j’en dis, Maître ? Qu’il n’y a pas un mot de vrai. […] Vous savez que je vous ai toujours dit la vérité. » (p. 178) Et pour finir, il passe à l’offensive en arguant qu’Amsby a probablement imaginé que son « mensonge » l’aiderait à obtenir le poste d’intendant qu’il convoite : « C’est un sale menteur, Maître, vous pouvez en être sûr. » Northup a convaincu Epps, lequel s’exclame alors : « Sacré, Amsby ! Nous le ferons dévorer par les chiens. » (p. 178) Si malgré son énormité, l’on peut avoir le sentiment que le mensonge de Northup n’en est pas vraiment un, c’est parce qu’en un certain sens son auteur dit vrai dans le faux : puisque la vérité à laquelle s’oppose ce mensonge est la fausse vérité de l’esclavage, alors ce mensonge sera un mensonge vrai. C’est que le système esclavagiste en tant que tel est fondé sur le mensonge, ainsi que l’affirme sans détour Bass que « la loi dit que vous avez le droit d’avoir un nègre ; mais, j’en demande pardon à la loi, elle ment. Oui, Epps, même si la loi dit cela, c’est un mensonge, et il n’y a pas un poil de vérité » (p. 205).
Ces techniques du mensonge s’intègrent à toute une gamme d’arts de la dissimulation, lesquels, en situation de domination et dans les termes de James C. Scott, sont également des « arts de la résistance »16. Il n’est pourtant jamais question chez Northup de célébrer l’inventivité et le pouvoir critique de la dissimulation en tant que telle, car celle-ci ne relève souvent que de l’automatisme, d’un quasi-habitus ; en ce sens, il y a déjà dissimulation lorsque l’esclave adopte face au maître « l’attitude et le langage d’un esclave » (p. 136). Si la dissimulation peut neutraliser pour un instant les rapports de force, elle ne saurait les transformer et ne fait donc que préparer leur reproduction et donc sa propre répétition : c’est une méthode de survie. Elle est néanmoins susceptible de se faire plus subversive, d’autant plus lorsqu’elle se fait collective et participe d’une mise en scène à plusieurs permettant de tromper le maître. Citons ce long passage qui en est un parfait exemple : « Durant les huit années où je servis comme surveillant, j’appris à manier le fouet avec une habileté et une précision extraordinaires, au point d’expédier les lanières, à un poil près, sur le dos, les oreilles et le nez, sans toutefois les toucher. Lorsqu’Epps nous observait à distance, ou que nous avions des raisons de penser qu’il se cachait dans les environs, je me mettais à faire claquer mon fouet, sur quoi, au terme, d’un accord passé entre nous, chacun se mettait à se tordre et à pousser des cris perçants, comme s’il était à l’agonie, bien que personne n’eût reçu la moindre égratignure. » (p. 172) La dissimulation ne peut aller sans simulation. Les arts de la dissimulation sont des arts du masque… un masque que le maître confond avec la peau de son esclave.
Si Northup résiste, c’est aussi parce qu’il ne perd jamais de vue la possibilité d’une évasion. Il le répète tout au long du récit : « J’élaborais des dizaines de projets d’évasion » (p. 38) ; « Je ne cessais de réfléchir à ma situation et aux moyens de tenter une ultime évasion » (p. 64) ; « J’ai appartenu dix ans à Epps, et pendant ces dix ans il ne s’est pas passé un jour sans que j’aie cherché un moyen de m’échapper » (p. 184) ; « Pendant douze ans je n’ai pensé qu’à la manière dont je pourrais m’échapper » (p. 212). Ne fussent-ils finalement que des songes creux, des chimères ou des fantasmes, à mille lieues de toute perspective de réalisation concrète, ces projets d’évasion n’en nourrissaient pas moins un indispensable imaginaire de la libération. Le rêve de libération de l’esclave prend enfin la forme de l’insurrection… et ici, le passage à l’acte est souvent beaucoup plus proche que ne pouvait ou ne voulait le soupçonner le maître, comme en témoigne le « complot » imaginé par Northup, Arthur et Robert sur le bateau qui les mène en Louisiane (pp. 46-49).
Ce que révèle cette « affaire », c’est qu’il existe toute une histoire souterraine de l’esclavage, une histoire des résistances « invisibles » ; un « texte caché » dans les termes de Scott, ignoré de l’histoire officielle. Cette autre histoire est totalement absente des archives du maître comme le dit déjà Northup : « Si [le capitaine] vit encore et que son regard tombe sur ces pages, il y trouvera, sur le voyage du brick, de Richmond à La Nouvelle-Orléans en 1841, la relation d’un fait qui ne figure pas dans son journal de bord. » (p. 49) Il y a enfin une histoire des insurrections déjouées, découvertes avant même leur commencement, comme celle préparée par Lew Cheney (pp. 164-165). Si de tels évènements n’échappent quant à eux pas au regard, au jugement et à la punition des Blancs, le point de vue (intérieur) de l’esclave n’en reste pas moins irréductible au point de vue (extérieur) du maître. De part et d’autre, les histoires ne sont pas les mêmes ; leurs personnages, la signification et la valeur attribuée à leurs actes, la mémoire des faits, tout change : « Il est probable que les journaux de l’époque en parlèrent ; ce que j’en sais provient uniquement du témoignage de ceux qui habitaient les lieux. On en parle encore dans toutes les cabanes du bayou, et cet évènement d’un intérêt indéfectible, parviendra aux générations futures comme l’un des plus marquants de leur histoire. » (p. 189)
Lutter
La libération de l’esclave ne devra-t-elle pas alors passer par une lutte, un corps-à-corps avec le maître ? Il n’est pas rare, souligne Northup, que l’esclave, « acculé à des actes incontrôlés, [aille] jusqu’à se retourner contre le maître » (p. 169). L’autobiographie de Frederick Douglass en avait donné un exemple saisissant à travers la scène capitale du combat contre Covey, le « briseur de nègres », auquel Douglass avait été loué par son maître, Auld : « Je résolus de me battre ; et passant à l’action, je saisis Covey à la gorge et me relevai. Il s’accrochait à moi et moi à lui. Ma résistance était tellement inattendue qu’il était pris de court. Il tremblait comme une feuille. Cela me donna de l’assurance et je pris le dessus, faisant couler le sang là où mes doigts le serraient. »17 Jamais plus après ce combat, Covey ne prendra l’initiative de fouetter Douglass. Ce dernier dévoile alors la signification fondamentale de cette lutte : « Ce combat avec M. Covey fut le tournant de ma carrière d’esclave. Il ranima les dernières braises mourantes de liberté et raviva le sentiment de ma dignité d’homme. Il me rendit confiance en moi et m’inspira de nouveau la détermination d’être libre. »18
Cet épisode s’offre, ainsi que l’a souligné Paul Gilroy, comme une alternative à l’analyse hégélienne de la maîtrise et de la servitude, comme son inversion ; car tandis que dans la Phénoménologie de Hegel, la lutte (des égaux) est ce qui crée les figures du maître et de l’esclave et donc le rapport (inégal) de domination qui les attache l’un à l’autre, chez Douglass, la lutte est ce qui défait le rapport des inégaux, et donc ses protagonistes eux-mêmes. Le « métarécit hégélien du pouvoir » est traduit en un « métarécit de l’émancipation »19. Or, ce renversement est aussi un bouleversement du rapport de l’esclave à la vie et à la mort20. Chez Hegel, le maître est celui qui, méprisant la mort, lui a préféré la liberté de la conscience ; l’esclave est celui qui, ayant refusé de risquer sa vie jusqu’au bout, s’est fait conscience servile. Il en va tout autrement chez Douglass comme l’explique Gilroy : « Pour [Douglass], l’esclave préfère l’éventualité de la mort à la perpétuation de la condition inhumaine sur laquelle repose l’esclavage de la plantation. »21 Au terme du récit de son combat contre Covey, Douglass peut donc écrire : « Ce triomphe me procura un plaisir qui compensait pleinement tout ce qui pourrait suivre, jusqu’à la mort elle-même. […] Je n’hésitai pas à faire savoir que l’homme blanc qui voudrait réussir à me fouetter devrait aussi réussir à me tuer. »22 Cette lutte de l’esclave et du maître, conclut Chamayou, ouvre de nouveaux possibles : non plus la liberté dans la mort, mais « la libération dans la vie par la médiation d’une confrontation au danger de mort ». Cependant, rien n’assure a priori que l’issue de la lutte, fût-elle « remportée » par l’esclave, soit la réconciliation effective de la vie et de la liberté23. L’exemple de Northup va en témoigner.
Que l’esclave soit prêt à risquer sa vie pour reconquérir sa liberté, Northup l’affirme très explicitement lorsqu’il évoque le complot imaginé par lui et ses compagnons sur le voilier qui les conduit à la Nouvelle-Orléans : « Arthur disait, et j’étais d’accord avec lui, que la mort était beaucoup moins redoutable que la vie que nous allions mener » (p. 47) ; « nous étions bien décidés […] à regagner notre liberté ou à perdre la vie » (p. 49). Il est alors légitime de supposer que c’est ce même sentiment et cette même détermination qui vont animer Northup lors de ses deux « bagarres » avec son maître Tibeats, des combats dont la proximité avec la lutte de Douglass contre Covey est saisissante : « Il était totalement en mon pouvoir. Je sentais tout son sang affluer. […] Dans ma frénésie, je m’emparai de son fouet. Il se débattit de toutes ses forces, jura que je ne reverrais pas le soleil se lever et qu’il m’arracherait le cœur. Mais ni ses efforts, ni ses menaces ne lui servaient de rien. Je ne saurais dire combien de temps nous restâmes à lutter » (p. 82).
Le choix de la lutte à mort est néanmoins beaucoup moins délibéré chez Northup qu’il ne l’était chez Douglass. Si Northup va jusqu’au bout, c’est parce que la situation elle-même est devenue « une question de vie ou de mort » (p. 88). Autrement dit, la lutte est le seul « choix » qui lui est laissé s’il veut ne pas perdre la vie ; c’est la seule alternative lorsque se révèle l’imminence d’une mort charnelle… au-delà de la mort sociale. Si Northup affirme qu’il a souvent songé à la mort comme à une libération, la lutte le rappelle pour ainsi dire à la vie : « lorsque sonne l’heure du danger, de telles pensées s’évanouissent. Aucun homme, en pleine possession de ses moyens, ne peut rester impassible face à la « reine de l’épouvante » : « Toute créature tient à la vie ; […]. Et moi, à cet instant précis, je tenais à la mienne, aussi asservi et maltraité que j’étais. » (p. 99) La terreur de la mort, ce « maître absolu » selon les mots de Hegel, dépasse alors la terreur de l’esclavage. Il y a, même au fond des ténèbres de l’esclavage, quelque chose qui résiste à la mort ; et ce quelque chose, c’est la vie elle-même, fût-elle une vie dévitalisée, une mort dans la vie.
Dans et par la lutte, l’esclave Northup prouve qu’il préfère la (sur)vie à la mort. On est très loin du mouvement de libération décrit par Douglass. On en est d’autant plus loin que pour Northup, cette lutte est sans issue, sans autre issue que sa propre mort. Son premier combat contre Tibeats est ainsi la source d’une profonde affliction, d’une atroce angoisse : « Une douleur inexprimable me submergea » (p. 83) ; c’est qu’il sait que rien d’autre ne l’attend après cette lutte que la potence : « Cette fois, j’allais devoir affronter les affres de la mort » (p. 84)… il n’y échappera que de peu. Son deuxième combat ne change pas la donne car qu’il donne la mort ou qu’il laisse la vie au maître – telle est à présent l’alternative qui s’ouvre à lui – la conséquence sera la même, à savoir sa propre mort : « J’avais peur de l’assassiner et peur de le laisser vivre. Si je le tuais, il me faudrait payer ce crime de ma vie ; mais s’il vivait, il ne lui faudrait pas moins que ma vie pour satisfaire ses désirs de vengeance » (p. 100). Pour Northup, la lutte à mort contre le maître est par définition une impasse ; elle ne promet aucune libération, ni au présent, ni dans le futur.
Le second combat de Northup fait néanmoins naître chez lui une résolution, à défaut d’une véritable solution : « À tout prendre, mieux valait errer à travers les marais, devenir un fugitif et un vagabond à la surface de la terre, que continuer la vie que je menais » (p. 100). À la dialectique du maître et de l’esclave se substitue alors ce que Chamayou a appelé une dialectique du chasseur et du chassé : « En regardant du côté du bayou, je vis Tibeats et deux autres cavaliers venir à toute allure, suivis par une meute de chiens. » (p. 101) La fuite instaure un nouveau rapport au maître, un rapport « médiatisé » par les chiens chasseurs : « Dans la situation de chasse, écrit Chamayou, le maître ne se confronte quasiment jamais directement à sa proie. Il utilise des intermédiaires, chasseurs mercenaires ou chiens de chasse. C’est un schéma à trois termes plutôt qu’à deux. »24 Northup décrit les premiers moments de sa fuite de la manière suivante : « Bientôt je pus entendre les jappements de la meute. […] Leurs aboiements se faisaient de plus en plus proches. À chaque instant, je m’attendais à ce qu’ils me sautent sur le dos, et je croyais sentir leurs crocs s’enfoncer dans ma chair. » (p. 102) Et l’auteur de relater comment, en s’enfonçant dans les eaux du bayou, il parvient à tromper les chiens, à leur faire perdre sa trace, son odeur. Dans la chasse, le rapport de l’esclave aux chiens est le rapport de la proie au prédateur : c’est un rapport animal25.
Cette « victoire » temporaire remportée sur les chiens ne signe pourtant aucun retour à l’humanité ; au terme de cette chasse, Northup se retrouve plongé dans un monde animal, où nulle âme ne vit, à l’exception des animaux sauvages : « ours, lynx, tigres » ; ainsi que d’« innombrables reptiles », sans oublier les « nombreux alligators » (p. 103) qui lui inspirent une horreur presque égale à celle qu’avaient éveillée les chiens. Il n’entrevoit alors plus aucune solution : « J’étais un animal errant. » (p. 93) Quitter ce règne de l’animalité ne peut plus signifier pour lui que faire retour au monde (in) humain de l’esclavage, s’exposer à la punition et peut-être à la mort. Ce choix n’est pas propre à Northup : « Bien qu’ils soient presque certains d’être rattrapés, les fugitifs n’en remplissent pas moins bois et marais. Nombreux sont ceux qui, affaiblis ou malade […] préfèrent subir la punition réservée à de tels délits. » (p. 185)
C’est le cas entre autres de Céleste dont la résolution semble pourtant au départ inébranlable : « Je préférerais mourir dans le marais plutôt que de me laisser fouetter à mort par l’intendant » (p. 188) confie-t-elle à Northup ; mais après plusieurs semaines de fuite, effrayée par le sort que lui réservent les animaux sauvages des marais, elle « rentra chez son maître, fut fouettée, mise aux ceps et renvoyée dans les champs » (p. 188). Parfois, l’esclave fugitif n’a même pas l’occasion de réaliser ce choix, tel Augustus mordu et mutilé à mort par les chiens (p. 187). Dans le récit de Northup, la fuite se présente, sinon comme une impasse à l’instar du combat contre le maître, du moins comme inévitablement vouée à l’échec26.
Quelle solution reste-t-il à l’esclave pour échapper à sa misérable condition ? L’insurrection ? Northup, qui remercie Dieu de ne pas lui avoir fait verser le sang sur le bateau qui le conduisait à la Nouvelle-Orléans (p. 46), écrit : « L’idée d’une insurrection n’était pas nouvelle parmi la population du Bayou Bœuf […]. Mais sans armes et sans munitions, ou même avec, je connais trop le genre de défaite par lequel se terminent de telles aventures, et je me suis toujours opposé à ceux qui en étaient partisans. » (p. 191) Il n’en affirme pas moins immédiatement après que si le système esclavagiste perdure, alors la terrible vengeance de l’esclave s’abattra un jour sur les maîtres qui « à leur tour imploreront, mais en vain, sa pitié » (p. 191). Si Northup ne se complait aucunement dans cette perspective qu’il présente sous un jour apocalyptique, il n’en espère pas moins que les torts infligés par l’esclavage seront vengés : « Bientôt, Arthur […] aurait la satisfaction de voir vengés les torts qu’on lui avait faits » (p. 52) ; « Il n’y aurait personne pour me pleurer, personne non plus pour me venger » (p. 84).Mais de cette vengeance, l’esclave n’en sera pas à proprement parler le sujet : elle ne s’accomplira vraiment que si ses prières sont exaucées par le « Père Tout-Puissant – qui règne sur nous tous, sur l’homme libre comme sur l’esclave » (p. 54). La justice (finale) à laquelle en appelle Northup est une justice divine exercée par un tribunal plus puissant que le « tribunal humain » (p. 248) ; mais c’est aussi une justice qui ne sera rendue qu’après la mort de tous les protagonistes, une justice qui ne peut conférer à l’esclave qu’une liberté au-delà de la mort, interdisant à nouveau toute réconciliation de la vie et de la liberté. Northup, lui, aura eu la chance de vivre sa libération, laquelle aura emprunté la voie d’une justice bien humaine, l’étroite voie juridique qui lui était ouverte en tant que citoyen « né libre, dans un État libre »… à la différence de ses compagnons nés esclaves dans un État esclavagiste.
Sujet et système
La « solution juridique » menant à la libération de Northup est une solution intrinsèquement individuelle. Or, l’on peut se demander si, en deçà de ces ultimes moments de sa vie d’esclave, cette individualité, cette différence, n’a pas marqué toute son expérience de l’« institution singulière » ; d’où les questions suivantes : le « point de vue de l’esclave » Northup représente-t-il réellement le « point de vue des (autres) esclaves » de son récit ? Dans quelle mesure le « je » de Northup est-il aussi un « nous » ? Northup demeure quoiqu’on en dise un étranger dans ce système : il lui est à la fois intérieur et extérieur ; il en est à la fois un acteur (une victime) et un observateur : « J’avais respiré toute ma vie l’air libre du Nord. J’étais conscient d’éprouver les mêmes sentiments, les mêmes impressions que les Blancs. » (p. 16)
Epps ne se trompe au fond pas lorsqu’il affirme de lui : « Fichtre, il n’est pas comme les autres nègres ; ne leur ressemble pas… n’agit pas comme eux. » (p. 219) Autrement dit, Northup s’indigne-t-il avant tout du système esclavagiste en tant que tel ou du fait que lui, né libre, ait été réduit en esclavage ? « Était-il possible que […] j’aie été enchaîné et battu sans pitié, et que fusse en ce moment parqué avec une troupe d’esclaves, et esclave moi-même ? » (p. 53) L’éditeur de la dernière version française en date de Douze ans d’esclavage (1980) l’affirmait sans détour pour clore son introduction : « Solomon Northup est bien pétri d’une des plus grandes contradictions de la société américaine : il a plus ressenti le scandale de sa situation d’homme libre, citoyen d’un État libre réduit en esclavage, que celui de l’esclavage proprement dit. »27 Si cette question mérite en effet d’être examinée, y répondre exige néanmoins bien plus de circonspection.
Quoique Northup affirme que la très grande majorité des esclaves chérissent la liberté tout autant que leurs maîtres, il donne pourtant plusieurs exemples d’esclaves à qui cette idée demeure totalement étrangère : « Mary […] connaissait à peine l’existence du mot liberté. Élevée comme une bête, elle n’avait guère plus d’intelligence qu’une bête » (p. 42). Il y a très manifestement pour Northup des degrés dans le sentiment de liberté et si celui-ci n’est jamais totalement éteint chez l’esclave, il est souvent réduit à presque rien. Pourquoi sinon Northup prendrait-il la peine de souligner qu’Eliza « n’était pas une esclave ordinaire. […] La liberté – liberté pour elle et pour ses enfants –, l’avait obnubilée, avait été le jour son étoile, et la nuit sa colonne de feu » (p. 62). S’il n’y a que très rarement du mépris dans les paroles de Northup à propos des autres esclaves, si s’y manifeste une indéniable solidarité, l’intensité du rapport à la liberté n’en reste pas moins pour lui un irréductible facteur de différenciation entre les victimes de l’esclavage.
Qui plus est, dissimuler sa liberté, sa condition d’homme libre, c’est non seulement pour Northup ne plus la dire au maître, mais c’est également « cacher à [ses] compagnons de tous les jours [son] nom et [son] histoire véritable ». Les esclaves pas plus que les maîtres ne connaissent son « secret » : « Il était impossible qu’aucun esclave puisse venir à mon aide, alors que, d’un autre côté, il était fort possible qu’ils me fassent découvrir. » (p. 211) Si Northup partage l’expérience et la vie quotidienne de ses compagnons de misère, leur présent, ses espoirs d’émancipation demeurent quant à eux profondément solitaires. D’où l’hébètement des esclaves au moment de sa libération : « Pendant dix ans, j’avais vécu parmi eux, travaillé dans le même champ, dormi dans la même cabane, supporté les mêmes épreuves, mêlé mes chagrins aux leurs et participé à leurs maigres joies. Et pourtant, jusqu’à cette heure, qui était la dernière que je devais passer parmi eux, aucun n’avait eu le moindre soupçon de mon véritable nom, ni su la plus petite parcelle de mon histoire. » (p. 235) Cette épisode dévoile le gouffre qui sépare Northup des autres esclaves, cette béance que la dissimulation avait précisément eu pour fonction de masquer, une différence que révèle encore l’apparente indifférence de Northup lors de la scène de séparation : « Tandis que je revenais vers l’attelage, Patsey sortit en courant de derrière une cabane et jeta ses bras autour de mon cou. “Oh ! Platt, s’écria-t-elle, le visage ruisselant de larmes, tu vas être libre…” […] Je me dégageai de son étreinte et montai à côté du conducteur. » (p. 239)
Qu’en est-il des relations de Northup aux maîtres ? Le lecteur du récit pourra s’étonner que l’auteur oppose systématiquement les « bons maîtres » (Ford, Mary McCoy) et les « mauvais maîtres » (Tibeats, Epps, Tanner), opposition qui est aussi celle des dignes serviteurs de Dieu et de ceux pour qui la Bible est avant tout un instrument d’assujettissement, un manuel de punitions. Il ne faudrait pourtant pas en inférer que, pour Northup, les bons maîtres échappent à toute critique, ni que la responsabilité de l’esclavage soit une responsabilité purement individuelle. Il affirme ainsi à propos de Ford : « Le milieu dans lequel il a toujours vécu ne lui a pas permis d’apercevoir l’injustice fondamentale sur laquelle repose le système esclavagiste. Il n’a jamais douté qu’un homme n’ait moralement le droit d’en assujettir un autre. » (p. 64) Il y a certes des maîtres humains et des maîtres inhumains, mais les uns non moins que les autres restent avant tout des maîtres, c’est-à-dire des bénéficiaires du système esclavagiste. C’est bien à une critique de l’esclavage en tant qu’institution que se livre Northup à propos duquel l’on peut répéter ce jugement porté sur Douglass en 1855 dans le Putnam’s Monthly Magazine : il « fait la guerre au système plutôt qu’aux personnes que ce système a produites »28.
Northup illustre bien comment l’« institution singulière » fait ses bourreaux non moins que ses victimes, crée le maître aussi bien que l’esclave. Ce « système inique » produit ses personnages, les forme même depuis l’enfance, tel le fils d’Epps, « garçon intelligent de dix ou douze ans » qui prend le plus grand des plaisirs à distribuer les coups de fouet aux esclaves : « “L’homme est en germe dans l’enfant”, et il est vrai qu’avec une pareille éducation, il ne saurait en être autrement, quelles que soient les bonnes dispositions de cette jeune nature : à l’âge de la maturité, il considèrera les misères des esclaves avec une totale indifférence. » (p. 202) Il n’en va pas autrement des femmes des maîtres, et notamment de Madame Epps qui brûle de jalousie envers l’objet des « regards lascifs » de son mari, l’esclave Patsey, « victime asservie de la luxure et de la haine » (p. 141). Madame Epps, qui à sa manière souffre elle aussi du système esclavagiste en tant que système sexuel, prend le plus grand plaisir à voir et à faire souffrir Patsey, allant jusqu’à intriguer pour « la faire tuer en cachette » (p. 141). Et pourtant, Northup écrit : « Malgré tout, Madame Epps n’était pas le diable en personne. […] Dans un autre contexte, au milieu d’une société différente de celle qui peuplait les rives du Bayou Bœuf, on aurait pu dire d’elle que c’était une femme raffinée et attachante. » (p. 149)
Si l’esclavage est par définition indéfendable, c’est parce qu’il est fondé sur l’identification et la réduction effective de l’esclave à un « bien personnel » – le code noir, régissant l’esclavage dans l’Empire français, parlait quant à lui de « meuble » –, une « propriété vivante, comparable en cela, sinon pour la valeur, à une mule ou un chien » (p. 137). L’esclave ne saurait avoir d’autre valeur qu’économique : ce que ne supporte pas Epps à l’idée que Northup pourrait mourir, c’est la perspective de « la perte que représenterait pour lui la mort d’un animal valant un millier de dollars » (p. 132). Il n’y a pas d’esclavage sans animalisation. Se demander ce qui distingue un Blanc et un Noir, ce n’est rien d’autre pour Epps que demander « quelle différence il y a entre un Blanc et un babouin » (p. 206). Mais cette répétition indéfinie de la proposition « le Noir est un animal », posée comme un a priori légitimant la pratique de l’esclavage n’est-elle précisément pas le signe de l’impossibilité d’une légitimation définitive, d’une preuve… car croirait-on utile de rappeler que le chien ou la mule ne sont pas des hommes ?
Ce que révèle par ailleurs Northup, c’est que ce processus d’animalisation est mutuel, c’est un processus d’ensauvagement récriproque : « sauvage », « brute », « bête », tels sont les épithètes dont il affuble les maîtres, du moins les mauvais maîtres. Et Bass fait sans doute bien plus qu’une boutade lorsqu’il rétorque à Epps assimilant les « nègres » à des singes : « À ce compte là, il y a autant de singes parmi les Blancs que parmi les Noirs. » (p. 206) Les mots suivants d’Aimé Césaire au sujet du colonisateur ne valent pas moins pour les maîtres décrits par Northup : « le colonisateur, qui, pour se donner bonne conscience, s’habitue à voir dans l’autre la bête, s’entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête »29. Pour Northup, l’esclavage est bel et bien un processus de décivilisation ; la société esclavagiste est une société malade, pervertie : « La pratique du système esclavagiste, sous sa forme la plus cruelle, tend à abrutir les quelques sentiments d’humanité et de délicatesse qu’ils pourraient avoir. Quand on sait les spectacles auxquels ils sont journellement confrontés – […] – quand on sait les souffrances qu’ils côtoient, comment pourrait-on encore s’attendre à les voir devenir autre chose que des brutes n’ayant aucun souci de la vie humaine. » (p. 153)30
Que Northup ne soit pas un esclave comme les autres, c’est indubitable ; que son « point de vue » sur l’esclavage soit unique, c’est certain ; qu’il ne soit pas en mesure de représenter tout à fait adéquatement les autres esclaves, de parler en leur nom (mais le prétend-il ?), c’est probable. Cela ne l’empêche pourtant en rien de produire une critique radicale de l’« institution singulière », irréductible à une expérience purement individuelle, étrangère à tout solipsisme. C’est que la perspective de Northup n’est pas seulement une perspective (subjective) sur l’esclavage, c’est aussi une perspective (intersubjective) sur d’autres perspectives, sur d’autres regards, ceux des autres esclaves aussi bien que ceux des maîtres. Northup apprend peu à peu à connaître les pensées et les sentiments des multiples protagonistes de la scène de l’esclavage, à voir à travers leurs yeux. Or, c’est précisément à l’intersection de ces multiples perspectives, et non pas indépendamment ou au-delà d’elles, qu’émerge au fur et à mesure du récit une critique de l’esclavage en tant qu’institution.
C’est pourquoi il est nécessaire pour conclure de réinterroger ce jugement accompagnant la réédition de 1869 de Twelve Years a Slave et repris dans la préface à l’édition de 1968 : ce récit, peut-on lire, « doit être pris pour ce qu’il vaut – un récit personnel des souffrances personnelles et des injustices ardemment ressenties et éprouvées très hostilement ; mais, à notre avis, l’individuel sera perdu ou se fondra dans l’intérêt général et l’œuvre sera regardée comme l’histoire d’une institution à laquelle notre économie politique s’est heureusement substituée »31. Ces deux aspects, « individuel » et « historique », de l’œuvre de Northup ne sont en réalité aucunement indépendants. Non seulement la dénonciation du système esclavagiste n’est en rien chez lui contradictoire avec l’expression de son point de vue sur l’esclavage, mais plus encore elle en est étroitement dépendante. Oublier ce que ce récit a de personnel, en effacer la valeur biographique, c’est dans un même geste en effacer la valeur historique, en oublier la portée critique. Se souvenir des luttes contre l’esclavage, c’est donc aussi se souvenir de la force de l’aveu de l’esclave.
1. F. Douglass, cité in S. Eakin, J. Logsdon, « Introduction » in S. Northup, Twelve Years a Slave, op. cit., p. ix.
2. Ibid.
3. Voir C. T. Davis, H. L. Gates Jr., The Slave’s Narrative, Oxford, New York, Oxford University Press, 1985, pp. 5, 11, 19. Le style même des slave narratives est la garantie de leur véracité : ce sont des récits écrits « sans art », « sans fard » (ibid., p. 29) ; quand bien même seraient-ce des fictions, des « miroirs » de la réalité, ceux-ci seraient du « meilleur verre poli » reflétant on ne peut plus fidèlement les « rayons de la vérité » (ibid., p. 6). La question de la vérité des récits d’esclaves engage par conséquent celle de leur statut en tant que « genre littéraire ». Les slave narratives ont été rapprochés du roman picaresque, du roman sentimental et de l’autobiographie spirituelle.
4. D. Wilson, « Editor’s Preface » (mai 1953) in S. Northup, Twelve Years a Slave, op. cit., p. xxxvII.
5. M. Foucault, Mal faire, dire vrai. Fonctions de l’aveu en justice, Chicago, Louvain, University of Chicago Press & Presses Universitaires de Louvain, 2012, p. 7.
6. Afin d’aller plus loin, il serait nécessaire de problématiser cette relation d’aveu en tant que relation triangulaire, incluant également la figure de l’abolitionniste ou plus généralement de l’écrivain qui retranscrit cette expérience. En ce sens, l’aveu est aussi celui que fait l’(ex-) esclave à son « nègre », un aveu qui n’est peut-être pas sans générer de nouveaux rapports de dépendance. Ne pouvait-on en effet pas lire dans l’almanach anti-esclavagiste de la Nouvelle-Angleterre de 1841 : « Choses à faire par les abolitionnistes, 1. Parler pour les esclaves… 2. Agir pour les esclaves… Ils ne peuvent pas s’occuper d’eux-mêmes » (C. T. Davis, H. L. Gates Jr., The Slave’s Narrative, op. cit., p. Iv) ?
7. F. Douglass, cité in C. T. Davis, H. L. Gates Jr., The Slave’s Narrative, op. cit., p. xiii.
8. E. Peabody, cité in C. T. Davis, H. L. Gates Jr., The Slave’s Narrative, op. cit., p. 20.
9. Voir O. Patterson, Slavery and Social Death. A Comparative Study, Cambridge, Londres , Harvard University Press, 1982.
10. O. Equiano, cité in G. Chamayou, Les chasses à l’homme. Histoire et philosophie, Paris, Éditions La Fabrique, 2010, p. 87.
11. G. Chamayou, Les chasses à l’homme, op. cit., p. 88.
12. O. Patterson, Slavery and Social Death, op. cit., p. 100-101.
13. Pour les autres esclaves, cet ailleurs demeure un lieu inconnu, situé « à une distance infinie », mais qui n’en nourrit pas moins leur imagination et leurs espoirs, leur « rêve de liberté » (p. 201). C’est une utopie.
14. Northup n’en devra pas moins sa libération à son aveu à un autre, Bass, dont il avait entendu à la dérobée la diatribe contre l’esclavage.
15. Ainsi que l’écrira Richard Wright pas loin d’un siècle plus tard, dans une société américaine post-esclavagiste encore habitée par les logiques raciales : « Automatiquement, nous déterminions si une réponse affirmative ou négative était attendue ; et nous répondions, non en terme de vérité objective, mais selon ce que l’homme blanc voulait entendre. » (R. Wright, 12 Millions Black Voices, New York , Thunder’s Mouth Press, 2002, p. 41.)
16. J. C. Scott, La domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, Paris, Éditions Amsterdam, 2009.
17. F. Douglass, La vie de Frederick Douglass, esclave américain, écrite par lui-même, op. cit., p. 113, p. 119.
18. Ibid., p. 120.
19. P. Gilroy, L’Atlantique noir. Modernité et double conscience, Paris, Éditions Amsterdam, 2010, p. 96.
20. « Pour l’esclave, la liberté commence avec la conscience que la vie véritable advient avec la négation de sa mort sociale. […] Le couple liberté-vie est une double négation, car, l’état de l’esclave étant déjà une négation de la vie, la revendication de cette vie passe par la négation de cette négation. » (O. Patterson, Slavery and Social Death, op. cit., p. 98 ; nous reprenons la traduction que propose Chamayou dans Les chasses à l’homme, op. cit., p. 91.)
21. P. Gilroy, L’Atlantique noir. Modernité et double conscience, op. cit., p. 99. Gilroy mentionne en outre la figure de Margaret Garner – dont Toni Morrison a réécrit et réinventé l’histoire dans son roman Beloved –, esclave qui préféra assassiner sa fille plutôt que de la condamner à une vie dans l’esclavage.
22. F. Douglass, La vie de Frederick Douglass, esclave américain, écrite par lui-même, op. cit., p. 120.
23. G. Chamayou, Les chasses à l’homme, op. cit., p. 92.
24. G. Chamayou, Les chasses à l’homme, op. cit., p. 98.
25. C’est aussi un rapport qui se construit en deçà de l’épreuve de la chasse, Northup expliquant comment, dans l’éventualité d’une nouvelle fuite, il lui avait été nécessaire de se « préparer à affronter les chiens » de Tibeats – en particulier le plus sauvage d’entre eux, qui « avait une véritable réputation de chasseur d’esclaves » – en les fouettant régulièrement pour les « soumettre entièrement » (p. 184).
26. Rappelons à nouveau que Northup était esclave dans une région du Sud des États-Unis d’où il était quasiment impossible de s’évader.
27. « Introduction de l’éditeur » in S. Northup, Douze ans d’esclavage, Paris, Le Sycomore, 1980.
28. Voir C. T. Davis, H. L. Gates Jr., The Slave’s Narrative, op. cit., p. 30.
29. A. Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence Africaine, 2004, p. 21.
30. Découvrir l’esclavage, c’est pour Northup comprendre que « l’homme est un loup pour l’homme » (pp. 25-26), locution que l’on pourrait reprendre ici dans sa « traduction » hobbesienne : le système esclavagiste, c’est le pur et simple retour à l’état de nature.
31. Voir S. Eakin, J. Logsdon, « Introduction » in S. Northup, Twelve Years a Slave, op. cit., pp. XXIII-XXIV.


